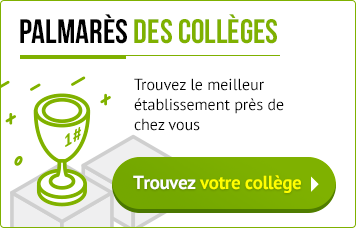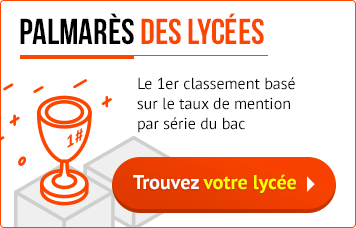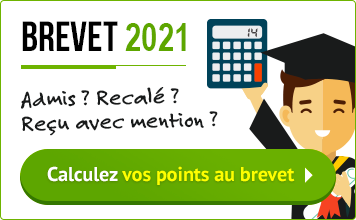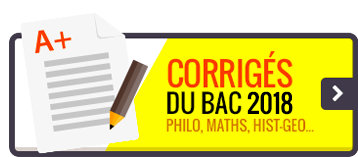Annales gratuites Bac ES : Travail et exclusion sociale
| Le sujet 1999 - Bac ES - Sciences Economiques et Sociales - Dissertation |

|
TRAVAIL ET EXCLUSION SOCIALE
Dans quelle mesure lexclusion sociale sexplique-t-elle par lévolution du marché du travail ?
DOCUMENT 1
Notre société produit de la pauvreté, en même temps quelle produit des marchandises. Le mécanisme essentiel de cette production de pauvreté est laccès à lemploi. [
] Les employeurs nont que lembarras du choix. [
] Il faut donc sélectionner dès lembauche, [
]
Cest dans cette sélection que naissent les processus dexclusion. Deux critères notamment jouent un rôle déterminant. Dabord, le parcours antérieur [
]. Le fait dêtre en chômage laisse peser une suspicion. [
] : si le candidat était " bon ", il aurait déjà retrouvé un emploi. Le chômage de longue durée stigmatise : à la façon dun marquage indélébile, il contribue à transformer ceux qui en sont victimes en exclus. [
]
Lécole, aussi, joue un rôle essentiel. Labsence de diplôme, la filière de formation, lâge de sortie de lécole jouent comme autant de signaux pour léventuel employeur. [
] Quitter lécole sans diplôme peut signifier, dans un certain nombre de cas, des difficultés de socialisation : un risque que lemployeur, la plupart du temps, se refuse à courir. Pour peu que lexclusion scolaire aille de pair avec quelques autres indicateurs - ladresse dun quartier réputé " difficile ", un teint un peu bronzé, ou un nom caractéristique, - et la machine à exclure fonctionnera sans coup férir.
Source : D.Clerc, " De la production de richesses à la production des exclus ",
Le Monde Diplomatique, Juillet 1992.
DOCUMENT 2
La vulnérabilité sociale* selon la situation par rapport à lemploi, (en % des actifs de 18 à 64 ans)
|
|
Personnes non vulnérables |
Personnes vulnérables |
Personnes très vulnérables |
|
Emploi stable non menacé |
74,2 |
21,6 |
4,2 |
|
Emploi stable menacé |
63,6 |
28,6 |
7,8 |
|
Emploi instable |
61,5 |
27,5 |
11,0 |
|
Chômage de moins de 2 ans |
61,5 |
27,1 |
11,4 |
|
Chômage de plus de 2 ans |
50,7 |
31,8 |
17,5 |
|
Ensemble |
68,0 |
25,0 |
7,0 |
Source : INSEE, Enquête situations défavorisées 1986-1987
in " Précarité et risque dexclusion en France ", Document de C.E.R.C., n°109,
La documentation française, 3ème trimestre 1993.
* La vulnérabilité sociale est mesurée par lintensité (forte, moyenne ou faible) des liens familiaux et relationnels (amicaux, associatifs
)
DOCUMENT 3
Quelque 1,4 million de personnes composeraient la " population à la dérive " qui, en dépit de toutes les politiques sociales mises en œuvre, ne parviendrait pas à se réinsérer dans la société française. [
]
Selon les estimations collectées, cette population " en grande difficulté sociale " recouvrirait 150 000 allocataires du RMI, 250 000 bénéficiaires dun contrat emploi-solidarité, 120 000 personnes en stages dinsertion, 300 000 jeunes âgés de moins de 25 ans (dont 100 000 hors de tout dispositif), 250 000 sans-domicile-fixe, 300 000 chômeurs de longue durée. Mais il ne faut sans doute pas oublier non plus les 3 millions de personnes illettrées recensées, dont 1,8 million sont dorigine française.
Les besoins des ces publics ne sont toutefois pas identiques dans la mesure où leurs " trajectoires " sont différentes. Ainsi le rapporteur* a-t-il identifié " trois grands groupes " nécessitant chacun une réponse appropriée : " les individus en situation de chômage et de très longue durée ", " ceux dont ladaptation sociale et professionnelle ne sest jamais complètement réalisée " et un groupe composé " de personnes sortant détablissements fermés " (hôpitaux psychiatriques, établissements pénitentiaires
).
Source :V.Devillechabrolle, "1,4 million de personnes seraient en situation de grande exclusion sociale ",
Le monde, 5 février 1994.
*M.Chasseriaux, dans le rapport "Précarité et risques dexclusion " remis au Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, en 1993.
DOCUMENT 4
Evolution de lemploi précaire en France.

Source : daprès INSEE résultats, Marché du travail, Séries longues, juin 1998.
DOCUMENT 5
Lexclusion est souvent le résultat de ruptures en chaîne. " Outre une rupture professionnelle pour bon nombre, la plupart des personnes que je reçois sont en situation de rupture avec leur famille ", témoigne Marcianne Pierre, responsable de lantenne RMI à la Mie de Pain, un centre dhébergement de nuit et de jour dans le XIIIième arrondissement de Paris. " les jeunes ont quasiment rompu avec leurs parents. Quant aux adultes, ils ont perdu leur conjoint ou ont divorcé et ils ne savent plus où aller. Souvent, ils disent ne pas vouloir alerter leur famille par honte de leur situation. Mais, sils ont honte, cest quils nen étaient déjà plus tellement proches ". On sait par exemple que 20% des allocataires de RMI ont connu une mesure de placement en famille daccueil dans leur enfance, alors que la moyenne est de 1% dans la population française.
Source : C. André, " La spirale de lexclusion ", Alternatives Economiques, n°114, février 1994.
DOCUMENT 6
La pauvreté disqualifiant renvoie davantage à la question de lexclusion quà celle de la pauvreté proprement dite. Sous ce rapport, cest la croissance constante des effectifs " dexclus " qui frappe lopinion. Ils sont refoulés hors de la sphère productive et deviennent dépendants des institutions daction sociale, tout en connaissant progressivement de plus en plus de difficultés. Il ne sagit pas, pour la plupart dentre eux, dun état de misère stabilisé, mais dun processus pouvant impliquer des variations soudaines de niveau de vie . A la précarité face à lemploi peuvent sajouter plusieurs handicaps : faiblesse du revenu, médiocrité des conditions de logement et de santé, fragilité de la sociabilité familiale et des réseaux sociaux daide privée, participation incertaine à toute forme de vie sociale institutionnalisée. La déchéance matérielle, même relative, et le dépendance inéluctable à légard des transferts sociaux - et surtout des mécanismes dassistance - induisent chez ceux qui vivent ces situations le sentiment dêtre pris dans un engrenage menant à linutilité sociale.
Source : S. Paugam, " La pauvreté dans lUnion Européenne ",
Sciences Humaines, Hors série n°14, septembre 1996.
I - ANALYSE DU SUJET
Le sujet proposé est une question classique du programme. Les liens entre l'insertion sociale et l'insertion professionnelle sont travaillés surtout dans les chapitres "Travail et emploi" et "Changement social et solidarités".
Le candidat doit cependant être attentif à rester bien centré sur le sujet et ne pas faire un "catalogue" des connaissances, en principe nombreuses, sur ce type de sujet.
Il s'agira donc de bien problématiser la question. Le candidat peut privilégier la situation en France.
II - CORRIGE DE LA DISSERTATION
INTRODUCTION
L'évolution du marché du travail se caractérise depuis une vingtaine d'années par une aggravation du chômage et de la précarité. Parallèlement se développe l'exclusion sociale. Il s'agit de montrer dans quelle mesure cette exclusion s'explique par l'évolution du marché du travail.
L'exclusion sociale ne peut se réduire à la pauvreté, phénomène qui est loin d'être nouveau.
Elle se caractérise par une rupture du lien social dont le vecteur essentiel est sans doute l'exclusion professionnelle. Celle-ci se présente donc comme une cause déterminante (partie I) mais qui ne saurait expliquer à elle seule le mécanisme d'exclusion sociale (partie II).
PARTIE I - LA DEGRADATION DU MARCHE DU TRAVAIL A INCONTESTABLEMENT RENFORCE LES MECANISMES DE L'EXCLUSION SOCIALE...
A - La pauvreté provient du développement massif du chômage et de l'augmentation de la précarité de l'emploi (doc 1).
1. La prise de conscience de la pauvreté provient de l'apparition, ces dernières années, des "nouveaux pauvres", dont la visibilité est plus grande.
2. Corrélation forte entre situation face à l'emploi et pauvreté (doc 3).
B - La situation sur le marché du travail entraîne par ailleurs une plus grande vulnérabilité sociale.
1. Corrélation entre situation sur le marché de l'emploi et vulnérabilité sociale (doc 2).
Précarisation de l'emploi et chômage entraînent la disparition des réseaux de sociabilité.
2. Processus cumulatif entre chômage de longue durée et employabilité (stigmatisation et difficultés de socialisation) (doc 1).
PARTIE II - ... MAIS NE PEUT A LUI SEUL EXPLIQUER LA RUPTURE DU LIEN SOCIAL.
A - L'exclusion sociale n'est pas un phénomène nouveau et provient des difficultés de l'Etat-providence à y répondre.
1. Permanence de la pauvreté même en situation de plein emploi durant la période des trente glorieuses (personnes âgées et familles à handicaps sociaux).
2. Incapacité - partielle - du système de protection sociale à répondre aux problèmes d'intégration et de pauvreté.
B - L'instabilité familiale est devenue une cause importante de rupture du lien social.
1. "Crise" de la famille et disparition des relations familiales (doc 5).
2. Sur-représentation des familles monoparentales parmi les familles pauvres (doc 5) ou bénéficiaires du RMI.
CONCLUSION
On peut donc considérer que la dégradation du marché du travail conduit à l'exclusion sociale alors que le travail reste, dans notre société, le vecteur essentiel de l'intégration sociale.
Cependant faut-il penser que dans une société où l'exclusion professionnelle se développe, le rôle socialisateur du travail puisse être incontournable ?
D'autres modes de sociabilité et d'intégration pourraient se développer ou se réactiver, tels la famille ou les associations...
Les sujets les plus consultés
- Sciences Economiques et Sociales bac es
Le rôle de l'école dans la mobilité socialeLes causes de l'exclusion socialeRelations entre fécondité et développement dInvestissement et croissanceCommerce international, croissance et développCoût du travail et chomageLa solidarité en FranceProgrès technique et croissance économiqueDurkheim et les faits sociauxHausse de la productivité et croissance écono
Les annales bac par serie
Les annales bac par matière
- Annales Bac français
- Annales Bac philosophie
- Annales Bac maths
- Annales Bac histoire
- Annales Bac géographie
- Annales Bac anglais
- Annales Bac espagnol
- Annales Bac physique
- Annales Bac chimie
- Annales Bac SVT
- Annales Bac sciences (enseignement scientifique)
- Annales Bac SES
- Annales Bac éco-droit
- Annales Bac management des organisations
- Annales Bac littérature