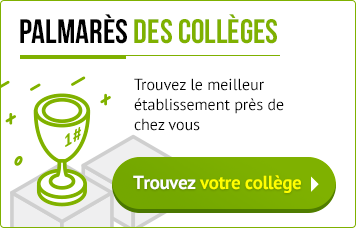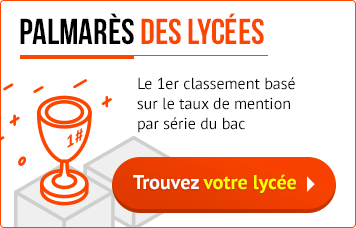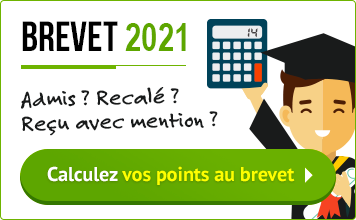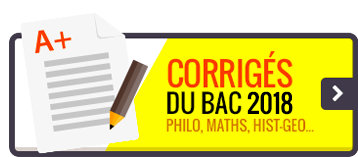Annales gratuites Bac Hôtellerie : Loi et liberté
| Le sujet 2009 - Bac Hôtellerie - Philosophie - Commentaire d'un texte philosophique |

|
|
Avis du professeur :
Le texte de Locke porte sur le rapport tout à fait classique entre la liberté et la loi. Le vocabulaire abstrait du texte peut être difficile à déchiffrer parfois. |
Pour
expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes,
qui sont destinées principalement à guider votre
rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes des
autres et demandent que le texte soit d'abord étudié
dans son ensemble.
La loi ne consiste pas tant à limiter un agent libre et intelligent qu'à le guider vers ses propres intérêts, et elle ne prescrit pas au-delà de ce qui conduit au bien général de ceux qui sont assujettis à cette loi. S'ils pouvaient être plus heureux sans elle, la loi s'évanouirait comme une chose inutile ; et ce qui nous empêche seulement de tomber dans les marais et les précipices mérite mal le nom de contrainte. De sorte que, quelles que soient les erreurs commises à son propos, la finalité de la loi n'est pas d'abolir ou de restreindre mais de préserver et d'élargir la liberté ; et dans toutes les conditions des êtres créés qui sont capables de vivre d'après des lois, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Car la liberté consiste à être délivrée de la contrainte et de la violence exercées par autrui, ce qui ne peut être lorsqu'il n'y a point de loi ; mais la liberté n'est pas ce que l'on nous dit, à savoir une liberté, pour tout homme, de faire ce qui lui plaît (car qui peut être libre quand n'importe quel homme peut nous imposer ses humeurs ?). Mais c'est une liberté de disposer et d'ordonner comme on l'entend sa personne, ses actions, ses biens et l'ensemble de sa propriété, dans les limites de ce qui est permis par les lois auxquelles on est soumis ; et, dans ces limites, de ne pas être assujetti à la volonté arbitraire de quiconque, mais de suivre librement sa propre volonté.
Locke
1. Dégagez la thèse de ce texte et mettez en évidence les étapes de son argumentation.
2.
a.
Précisez la conception de la liberté à laquelle
Locke s'oppose dans ce texte.
b.
En vous appuyant sur l'image de la ligne 4, expliquez : "guider
[un agent libre et intelligent] vers ses propres intérêts".
c.
Comment Locke définit-il la liberté ? Expliquez
cette définition en vous appuyant précisément
sur le texte.
3.
La loi est-elle la condition de la liberté ?
I – LA PRESENTATION DU TEXTE
●
Le texte
porte précisément, dans le chapitre la
liberté,
sur la notion de loi.
Il
pose le problème du rapport de la liberté à la
loi.
● Le texte ne présente pas de difficulté particulière. Pour comprendre son argumentation, il faut simplement repérer la thèse à laquelle il s'oppose.
II - L'IDEE GENERALE ET L'ARGUMENTATION
● L'idée
générale du texte peut-être cernée dans la
phrase : "Là où il n'y a pas de loi, il n'y a
pas de liberté". En d'autres termes, dans toute
communauté humaine, la loi est la condition de la liberté
de chacun.
Il faut comprendre ici la notion de loi
dans son sens juridique
et politique :
c'est une règle obligatoire établie par une autorité
souveraine et régissant les rapports des hommes au sein d'une
même communauté. Par son objet, la loi est générale :
elle s'adresse à tous, abstraction faite de l'intérêt
particulier
des individus ou groupes distinctifs.
● On peut distinguer deux mouvements dans l'argumentation :
De "La loi ne consiste pas tant" jusqu'à "là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté", l'auteur dégage la finalité de la loi : "préserver et élargir la liberté" de chacun dans le souci d'une liberté commune. L'image des "marais" et des "précipices" suggère que la loi n'est ni une "limite" ni une "contrainte" à notre liberté individuelle, mais plutôt un "guide", et même un garde-fou contre le caprice irrationnel des volontés particulières. Elle rend notre liberté plus raisonnable, et donc plus effective.
De "Car la liberté consiste" jusqu'à la fin, l'auteur précise sa thèse en l'opposant à une autre conception : ceux qui pensent la loi comme une limite et une contrainte à la liberté conçoivent cette dernière comme la possibilité pour chacun de "faire ce qui lui plaît", ce qui est proprement confondre la liberté de la volonté avec le caprice du bon plaisir. L'absence de loi réintroduit les rapports de force et de soumission. La loi au contraire nous garantit contre l'arbitraire des volontés particulières, nous délivre "de la contrainte et de la violence exercées par autrui".
III - LES EXPLICATIONS
a. La
conception de la liberté à laquelle Locke s'oppose dans
ce texte est celle qui confond liberté
et bon
plaisir. Etre libre, ce serait "pour
tout homme, faire ce qui lui plaît". C'est une conception
irrationnelle, fausse et dangereuse de la liberté, du point de
vue individuel comme collectif.
●
Du point de vue individuel, c'est penser que la liberté
n'est pas dans la détermination d'une volonté
raisonnable mais dans l'humeur irrationnelle du penchant, qui nous
fait "tomber dans les marais et les précipices" des
actions vaines, inconsidérées ou périlleuses.
●
Du point de vue collectif, c'est accepter le fait que
chacun puisse vouloir "imposer ses humeurs" aux autres,
"être assujetti à la volonté arbitraire de
quiconque", être livré à "la contrainte
et la violence exercées par autrui". Cela revient à
réintroduire les rapports de force entre les hommes au
détriment de la liberté de tous.
b. Pour
Locke, la loi serait le meilleur guide pour une volonté
raisonnable, consciente de ses intérêts et réfléchie
sur les moyens de les satisfaire, qui concilierait intérêt
privé et "bien général", ainsi que
liberté de chacun et liberté de tous.
L'image des
"marais" et des "précipices" suggère
que, sans loi, nous sommes exposés aux périls de nos
propres excès, à l'irrationalité de nos
pulsions, et aux caprices et "humeurs" des autres.
c. Pour
Locke, la liberté consiste à "suivre sa propre
volonté" dans les "limites de ce qui est permis par
les lois auxquelles on est soumis".
La liberté est
celle d'une volonté individuelle raisonnable
("libre et intelligent"), capable de se conduire de manière
réfléchie et prévoyante ("disposer et
ordonner [...] sa personne, ses actions, ses biens").
C'est
une liberté orientée "vers ses propres intérêts"
qui consent cependant à obéir aux lois, y reconnaissant
la garantie du "bien général" et de la
liberté commune, en particulier comme protection par rapport à
"la volonté arbitraire de quiconque", à "la
contrainte et la violence exercées par autrui".
Enfin,
elle a compris qu'en obéissant à la loi générale,
elle n'avait à obéir à personne en particulier.
IV - LE SUJET DE REFLEXION
Le sujet de réflexion ne fait que reprendre la thèse du texte sous la forme d'une question. Le mot "condition" permet toutefois d'élargir la réflexion : condition nécessaire ? Condition nécessaire et suffisante ? Quelles autres conditions de la liberté ? On peut même envisager une perspective plus ouverte avec la notion de loi morale.
● Soutenir que la loi n'est qu'un obstacle à la liberté est difficilement défendable. On peut cependant se référer à l'argumentation de Calliclès dans le Gorgias de Platon qui oppose la loi conventionnelle à la loi naturelle, la loi empêchant les plus forts d'exprimer leur liberté.
● Il
faut cependant relever les limites d'une telle argumentation, en
particulier dans l'ambiguïté de l'expression "le
plus fort". L'argumentation de Locke est plus convaincante, à
condition cependant que, comme l'a souligné Rousseau dans le
Contrat
social,
la loi soit bien l'expression de la volonté
générale.
Car
il ne suffit pas que la loi soit générale par son
objet, encore faut-il qu'elle le soit aussi par sa source. Si la loi
n'est que l'expression de la volonté
particulière
d'un groupe, d'un clan, d'une classe sociale ou d'un individu qui
s'impose à tous, alors elle n'est que le masque de la
contrainte, et ne représente plus l'essai d'organisation
raisonnable d'une liberté commune.
Les sujets les plus consultés
Les annales bac par serie
Les annales bac par matière
- Annales Bac français
- Annales Bac philosophie
- Annales Bac maths
- Annales Bac histoire
- Annales Bac géographie
- Annales Bac anglais
- Annales Bac espagnol
- Annales Bac physique
- Annales Bac chimie
- Annales Bac SVT
- Annales Bac sciences (enseignement scientifique)
- Annales Bac SES
- Annales Bac éco-droit
- Annales Bac management des organisations
- Annales Bac littérature