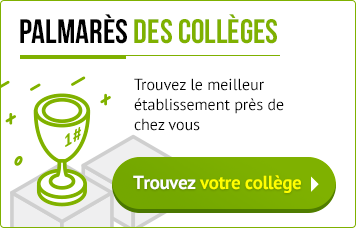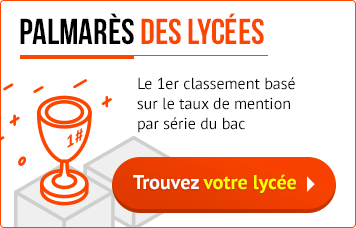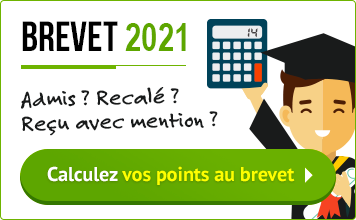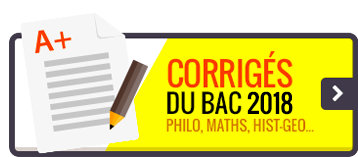Annales gratuites Bac L : La porte de la Loi
| Le sujet 2005 - Bac L - Littérature - Question |

|
Etudier l'apologie de la Porte de la Loi dans Le Procès de Kafka et Le Procès de Welles.
I - L'ANALYSE DU SUJET
Il importe d'abord de retrouver, pour soi-même, le contenu de l'apologue. L'homme de la campagne qui veut connaître la loi, qui en est empêché par les propos du gardien et qui mourra, finalement, sans l'avoir approchée. Mais ce qui importe le plus, c'est d'interroger cet apologue : l'apologue est en effet un court récit qui a une visée morale. On pourra ainsi se demander quel est le sens, les sens, de cet apologue ? Comment le personnage de cet apologue pourrait représenter K. lui-même ? En quoi pourrait-il être représentatif de la signification générale du roman ? Car on se doute que si le sujet porte sur un passage précis du texte, c'est bien pour que le candidat montre l'importance du passage pour la compréhension globale de l'oeuvre. Dans une oeuvre aussi complexe, la signification de l'apologue sera multiple voire contradictoire.
Il faut, par ailleurs, confronter ce qu'on tire du roman de Kafka avec le traitement qu'en fait Welles dans son film. Il s'agira surtout de montrer les différentes manipulations que le cinéaste fait subir à cet apologue et chercher à comprendre les enjeux respectifs du passage dans le film et dans le roman. On pourra tout à fait admettre, vu le temps limité et l'importance du propos, un plan en deux parties (l'une pour Kafka, l'autre pour Welles), à condition bien sûr que la confrontation des deux interprétations soit clairement mise en place.
II - LES REACTIONS A CHAUD DU PROFESSEUR
Bien que le sujet porte sur un élément du roman, son importance est majeure car l'épisode en question est un moment-clé du roman. Le candidat ne pourra pas, bien sûr, avoir en mémoire toutes les subtilités de l'apologue et de la discussion qui le suit. Il devra pourtant synthétiser les différentes interprétations qu'on peut en tirer sans pouvoir jamais vraiment conclure. Il en sera de même pour le film de Welles dont il faudra rappeler quelques éléments précis.
Le fait que le sujet soit noté sur huit points ne doit pas en diminuer l'importance. Dans ce sujet, en effet, le correcteur pourra apprécier si le candidat a maîtrisé l'essentiel du roman de Kafka. La notation sur huit points permet d'être plus allusif et plus rapide que je ne le suis dans ce corrigé quant aux références au film et au roman.
III - UN TRAITEMENT POSSIBLE DU SUJET
L'apologue de la porte de la Loi
rapporté par le prêtre dans l'avant-dernier chapitre du Procès de Kafka revêt une importance particulière. En effet, jusqu'alors, ce qu'on a appris de la loi provenait des propos tenus par l'avocat Léni, la femme de l'huissier ou par le peintre Titorelli, lequel signale à Joseph K. que les délibérations sont tenues secrètes. Quant aux livres qui figurent sur la table du juge d'instruction, leur contenu est scabreux. C'est dire que le seul texte qui soit une source officielle est précisément celui de la parabole qui figure dans " les textes introductifs" de la Loi. Celle-ci semble ou tenue secrète ou dévoyée et n'est abordable que dans un préambule. On retrouve là un des aspects essentiels du roman : la loi est introuvable. L'importance de ce passage n'a pas échappé à Welles qui l'utilise à la fois au début de son film pour le reprendre une seconde fois vers la fin.Dans le roman de Kafka, l'apologue est source d'interprétations différentes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'apologue en lui-même mais les commentaires multiples qu'il suscite chez K. et le prêtre. Son sens n'est pas univoque. K. comprend d'abord que l'homme de la campagne, quand il apprend que la porte devant laquelle il a attendu et où il va mourir, n'était destinée qu'à lui seul, a été trompé par les propos du gardien et qu'il en est donc comme la victime. Mais le prêtre réplique aussitôt que le gardien a parlé loyalement et que c'est un personnage sûrement vaniteux mais positif. Plus loin le débat inversera les responsabilités : l'homme de la campagne est resté volontairement assis à la porte de la loi. On voit que beaucoup plus qu'une approche explicative de la loi, cette parabole constitue un réseau de questions : qu'y a-t-il derrière la porte ? La loi est-elle accessible ? Existe-t-il des figures répressives qui en interdisent l'accès ? Comment la Loi, a priori de nature universelle, peut-elle constituer une entité personnalisée pour celui qui l'approcherait ? On sent bien que c'est dans ce passage que se mesurent la profondeur et l'ambiguïté du texte de Kafka : K. découvre dans cette parabole sa propre impuissance ou sa propre résistance à aller vers la loi, vers ce procès dont il sent bien dès le début qu'il lui est essentiel, mais vers lequel il ne se décide pourtant pas à aller. On peut tout aussi bien considérer que le texte laisse planer un doute sur l'existence même de cette Loi, d'autant qu'elle figure dans une parabole, forme archaïque de la parole qui laisse entendre que le caractère sacré de la Loi est de l'ordre du passé. Que son existence est une légende d'autrefois à moins que ce ne soit la faiblesse de l'homme qui le détourne de la connaissance de la Loi et de sa rigueur ?
Dans le film de Welles, l'apologue de la loi est non pas l'objet d'un débat entre le prêtre et K. mais d'un véritable combat entre K. et l'avocat. Il est notable que Welles, qui joue par ailleurs le rôle de l'avocat, a modifié la narration de Kafka sur ce point : en faisant intervenir l'avocat que K. avait désengagé de sa propre affaire, Welles fait de l'homme de loi une figure forte et oppressante : il intervient dans la cathédrale pour s'opposer à la rébellion qui germe chez Joseph K. et le replacer dans la dépendance de la justice. Les projections des tableaux d'épingles illustrant les différentes étapes de l'apologue placent K. et l'avocat dans un rapport de forces constant : tantôt K. est comme traversé par la projection et semble incorporé de force à l'apologue, tantôt c'est devant un écran blanc et lumineux (illustration du vide la justice ? ou de la lumière qui provient de derrière la porte de la Loi ?) que K. défend sa liberté face à un avocat devenu un juge qui condamne les tentatives de liberté de son ancien client. C'est du reste une des différences majeures entre le film et le roman que cette résistance tardive de K. et la dénonciation par Welles de l'omnipotence tyrannique de la justice et du pouvoir qui cherche à écraser l'individu.
On a vu que chez Kafka la question portait davantage sur le rapport personnel et intérieur de l'individu à la loi. On peut d'ailleurs penser que la présence par deux fois de l'apologue dans le film de Welles et sous la forme d'images fixes, enchaînées comme des diapositives, est une façon pour Welles de prendre de la distance : il désignerait par là que l'apologue est de la main d'un autre, qu'il renvoie au texte de Kafka explicitement nommé dans le prologue et dont Welles s'éloignera librement, qu'il constitue peut-être, par la reprise à la fin du film, comme une sorte de vieille histoire que l'on raconte pour mystifier les hommes et s'assurer du pouvoir sur eux. On peut penser que cette scène constitue aussi une réflexion sur les pouvoirs de l'image, sur la puissance d'invention, voire de falsification, que détient l'avocat-cinéaste qu'est Orson Welles.
L'importance de cet apologue, dans le film comme dans le roman, se mesure aussi à la reprise constante de la structure qu'il met en place : un gardien devant une porte conduisant à une entité désirée et redoutée : on pense, dans le film, à la petitesse de K. face aux portes immenses de la salle d'instruction qu'il a quittée ou aux innombrables portes qu'il faut franchir pour suivre la femme de l'huissier emportée par l'étudiant en droit. Aux dédales des couloirs et des portes de l'ancienne Gare d'Orsay, à la porte, inventée par Welles qui offre une communication entre la chambre de K. et de Melle Bürstner et par laquelle, ironie, surgit l'inspecteur au début du film, comme un gardien venu dénoncer la possible liaison entre K. et la jeune femme. Comme si Welles dénonçait ainsi toutes les entraves mises au désir humain.
La récurrence du motif est tout aussi forte chez Kafka : derrière la porte de Melle Bürnster veillera Melle Montag ou le neveu de Mme Grubach. Aux fenêtres sont postées un couple de vieux encadré par un géant roux. Pour s'informer de la localisation de la salle d'audience de son propre procès, K. doit se faire ouvrir de nombreuses portes, la porte de Titorelli, dont le juge a la clef, donne sur les bureaux du greffe... On pourrait multiplier les références pour monter combien la structure qui associe à la fois le désir de passer et la répression du passage, son empêchement, est omniprésente dans le roman. Elle figure toute l'ambiguïté de la démarche de K. et constitue un rappel permanent de sa culpabilité qui est comme double puisqu'elle est à la fois la conscience trouble de la faute et le sentiment de n'en pas faire assez pour éclairer la nature de la faute et donc la nature de la loi.
On a pu constater que l'apologue est un moment-clé du roman même s'il n'apporte pas une solution à la compréhension de la loi, la rendant encore plus problématique par les débats que l'apologue suscite. Néanmoins, l'accent est mis sur la responsabilité individuelle de l'homme face à la loi et à la connaissance de celle-ci. Le procès serait dès lors davantage le processus personnel par lequel un individu cherche et refuse la Loi. Dans le film, l'importance est aussi grande mais elle est détournée vers une dénonciation de la puissance oppressive et du pouvoir suggestif des images.
IV - LES ERREURS A EVITER
Il fallait éviter de :
Les sujets les plus consultés
- Littérature bac l
Quitter le monde de la Cour et des grandsLa vie est un songeLa figure de Chaka dans EthiopiquesBlanchefleur et PercevalSophocle l'hybrisLa figure maternelleLe mouvement chez MontaigneL'unité des quêtes de LancelotTristan et Iseut s'aiment-ilsDiderot joue avec les attentes de son lecteur
Les annales bac par serie
Les annales bac par matière
- Annales Bac français
- Annales Bac philosophie
- Annales Bac maths
- Annales Bac histoire
- Annales Bac géographie
- Annales Bac anglais
- Annales Bac espagnol
- Annales Bac physique
- Annales Bac chimie
- Annales Bac SVT
- Annales Bac sciences (enseignement scientifique)
- Annales Bac SES
- Annales Bac éco-droit
- Annales Bac management des organisations
- Annales Bac littérature